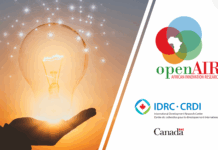By Thomas Hervé Mboa Nkoudou
Du 6 au 10 mai 2018, la ville de Dakar accueillait le Festival Afropixel 6 sur la thématique « Utopies non-alignées : Imaginaires numériques ». À cette occasion, j’ai été invité (en compagnie de Daniel Sciboz) à préparer et modérer le débat qui s’est tenu le 08 Mai 2018 au Kër Thiossane sur « Arts et métiers du numérique au Sénégal : le Fablab entre promesses et perspectives locales ». Ce billet rappelle les riches discussions auxquelles ont pris part à cette occasion plusieurs représentants et représentantes d’espaces engagé-e-s dans le mouvement maker au Sénégal et ailleurs.
Nos échanges ont débuté par la présentation des différents orateurs et oratrices et de leur motivation à créer un Fablab. Ensuite, nous avons orienté le débat vers des questions économiques, managériales et socioculturelles qui ont fait émerger les dilemmes que j’expose dans ce texte.
À la source des fablabs
Les intervenants et intervenantes et leur motivation à créer des espaces d’innovation étaient :
- Marion Louisgrand Sylla, dont le Fablab “Defko Ak Niep” (Fais-le avec les autres) est rattaché au Kër Thiossane, un espace culturel et multimédia pour l’imagination artistique et multimédia ;
- Ibrahima Gueye, qui dirige le PolyLab, un atelier de fabrication numérique installé sur le campus universitaire de Thiès ;
- Ibrahima Guissé, maître maroquinier formé aux métiers de la cordonnerie et de la maroquinerie par son père et qui exerce aujourd’hui son art dans la fabrique familiale de Ngaye Mekhé ;
- Cecile Ndiaye du Studio Wudé, une maison de maroquinerie.
Afin d’avoir une vision autre que celle du Sénégal dans ce débat, le panel accueillait également[1] :
- Sénamé Koffi Agbodjinou (Togo), fondateur du Wɔɛlab, le tout premier Fablab en Afrique francophone ;
- Yaw DK Osseo-Asare & Yasmine Abbas (Ghana/USA & France), qui ont conçu le Agbogbloshie Makerspace Platform (AMP) Spacecraft, un espace de workshop ouvert fait à partir des déchets de fer.
- Laurent Malys (France), artiste et programmeur. A Kër Thiossane, il a animé plusieurs ateliers sur le design génératif et la fabrication électronique.
Les propos de ces personnes lors du panel ont montré que leur motivation à créer un espace n’était pas toujours la même. Trois cas de figure se sont présentés. Dans le premier cas, la motivation est venue d’une intuition personnelle liée soit à la pertinence d’implémenter un espace d’innovation ouvert dans un contexte donné, comme cela a été le cas pour le Wɔɛlab, soit à la nécessité de transmettre et préserver un savoir-faire traditionnel dans un contexte de mondialisation, comme c’est le cas avec le Studio Wudé ou la Fabrique du village de Ngaye Mekhé. Dans le deuxième cas, c’est le désir de répondre aux besoins d’une communauté précise souhaitant mieux gérer son environnement immédiat qui est à l’origine du projet. C’est le cas du « DefKo Ak Niep » qui a répondu au besoin de créer à Dakar un espace de partage ancré dans son territoire à travers la culture, l’art et le numérique, tout comme du APM-Spacecraft né à Agbogbloshie (Ghana) à la suite de la volonté d’assainir les conditions de vie en recyclant les déchets métalliques. Finalement, une troisième motivation réside dans la volonté d’une institution d’offrir un cadre d’innovation permettant d’assurer la visibilité ou encore l’épanouissement et l’expression de ses membres. Tel est le cas du Polylab, né de la volonté de l’Université de Thiès d’offrir un cadre pédagogique à ses enseignants et étudiants, leur permettant de réaliser des prototypes.
Dilemmes économiques
Bien que les motivations à créer les Fablabs ne soient pas directement liées au courant qui présente le mouvement maker comme une nouvelle révolution industrielle[2], il est utile de s’interroger sur les attentes économiques des promoteurs lorsqu’ils et elles ont créé leurs espaces. Toutes les personnes qui se sont exprimées sur la question (Woelab, Ker Thiossane, Polylab, AMP) ont été unanimes : ils n’avaient pas d’attentes particulières sur le plan financier. Ils s’inscrivaient en premier lieu dans la logique du service à la communauté et souhaitaient rester fidèles au maximum à l’éthique hacker, aux valeurs de partage et de démocratisation des connaissances. D’où leurs activités gratuites dans la rue, dans les écoles, lors des évènements, en direction du grand public, des jeunes du quartier, des femmes, etc.
Cependant, les intervenants et intervenantes n’ont pas hésité à souligner que ces activités ont un coût en termes de temps, de ressources humaines, matérielles et financières. Comme le mentionne Marion de Kër Thiossane, « à chaque fois qu’il y a une activité grand public, les équipes reviennent fatiguées, les imprimantes rentrent déréglées…et ça demande du temps pour remettre tout ça à jour ». N’ayant pas toujours le soutien des politiques, encore moins des personnes qui viennent en majorité dans les Fablabs (la plupart sont sans emploi stable), ces Fablabs se trouvent donc dans une situation économique précaire qui les amène à survivre au jour le jour, sans véritable assurance d’une autonomie financière. Cette question est d’ailleurs venue de l’assistance : comment les Fablabs assurent-ils leur autonomie financière, s’ils ne se consacrent qu’aux services gratuits à la communauté malgré les charges qui leurs incombent (électricité, eau, achat du matériel, salaire du fabmanager) ?.
Pour le Polylab, la réponse est assez claire : l’espace reçoit un appui institutionnel de l’Université de Thies. Le Studio Wundé a mentionné avoir ses propres moyens et bénéficier de certaines subventions. La Fabrique de Ngaye Mekhé ne s’est vraiment pas exprimée sur la question, peut-être à cause de l’orientation commerciale de ses activités. Ce silence peut aussi être révélateur d’une certaine autonomie financière. Quant au Woelab et au Ker Thiossane, il est clair que leurs activités ne sont pas faites dans une visée lucrative, mais s’inscrivent plutôt dans une logique de sensibilisation, d’accompagnement et de prototypage rapide. Leurs principaux revenus proviennent donc des subventions d’organismes internationaux et des dons ; vu le caractère aléatoire, irrégulier et rare de ces modes de financement, ils sont obligés d’externaliser certains de leurs services en réalisant des petites commandes qui leurs sont souvent proposées. Malgré ces stratégies, ces deux derniers Fablabs ne sont vraiment pas autosuffisants, certains des promoteurs étant même tentés de laisser tomber leur espace. Le public présent, reconnaissant l’impact positif que les Fablabs ont eu sur certains d’entre eux, dans leurs quartiers ou villes, ont fait un certain nombre de recommandations en vue d’assurer la viabilité des Fablabs : repenser l’économie en termes de valeurs et non seulement de monnaie, greffer les Fablabs à un écosystème mature existant (une famille, une structure, une entreprise…), penser à un modèle économique capable de permettre des rentrées de fonds. Cette dernière option a divisé le public, car une frange puriste estimait que les Fablabs ne sont pas faits pour produire de l’argent. D’un autre côté, le problème de la viabilité doit être posé, d’où cette très belle question posée par Sénamé Koffi : « Qu’est-ce qui fait que l’argent obtenu via les subventions soit plus propre que l’argent qu’on génère par notre propre travail ? Pourquoi toujours courir après les gros organismes pour demander les financements, alors qu’on peut en générer soi-même par le travail ? ». D’où ce dilemme économique auquel les Fablabs font face : rester dans la posture traditionnelle de service à la communauté, sans adopter un modèle économique pouvant assurer la viabilité financière de l’espace ; ou le faire et se rapprocher d’une entreprise.
Dilemmes socioculturels
Il faut reconnaître que tous les Fablabs du monde font face au dilemme économique que je viens de décrire. En Afrique cependant, au-delà de cette question économique, les Fablabs sont aussi le théâtre d’enjeux socioculturels importants qui mettent en évidence, d’une part, les disparités au niveau de la culture numérique et, d’autre part, les tensions entre les valeurs horizontales (partage, collaboration, transparence, ouverture) prônées par les Fablabs[3] et les valeurs verticales de respect (de la hiérarchie, des tabous, du droit d’aînesse, du secret, etc.), fortement ancrées dans la société africaine. Les disparités dans la culture numérique sont bien visibles dans le propos du responsable de la Fabrique de Ngaye Mekhé, qui indique que, depuis plus de deux ans, il possède une CNC (un des appareils phares des Fablabs) qu’il n’arrive pas à utiliser, parce que personne n’a les compétences requises pour le faire. Ceci confirme que la disponibilité de l’équipement technologique ne garantit pas toujours son appropriation et son usage par les personnes concernées. C’est un symptôme de la fracture numérique de second niveau, qui est liée aux différentes façons d’utiliser ou de pratiquer la technologie[4] ; elle diffère de la fracture de premier niveau qui concerne l’accès à l’équipement. Cette disparité amène à questionner le type d’équipements et les compétences requises pour faire d’un espace un lieu d’innovation. La présence et/ou l’exigence d’équipements numériques dans les Fablabs serait-elle un effet de marketing ou la volonté de se conformer à une mode ? Quelle en est la pertinence dans une communauté sans compétences numériques ?
Quant à la tension entre les valeurs horizontales des Fablabs et les valeurs verticales africaines, elle s’est manifestée sur plusieurs plans. Sur le plan managérial, les intervenants et intervenantes ont été unanimes sur le fait qu’il est quasiment impossible de gérer un Fablab de façon horizontale et ouverte. Un système hiérarchique très fort calqué sur les valeurs verticales de la société africaine serait alors un gage de bon fonctionnement de la structure. Bien qu’elles soient adaptées au contexte, les valeurs verticales africaines vont à l’encontre de l’éthique hacker ; quel choix faire face à ce dilemme ?
Sur le plan de la gestion de la communauté, les intervenants et intervenantes (Woelab, Ker Thiossane) ont indiqué être ouverts à tout le monde et essayer d’être les plus inclusifs possible en impliquant chaque personne dans la vie de l’espace. Toutefois, cette volonté d’inclusion est fragile face à certaines réalités qui poussent à reconsidérer les modalités d’implication de certains acteurs. En effet, c’est avec beaucoup de regrets que le Woelab et le Ker Thiossane déplorent la présence d’individus qui viennent juste pour acquérir des savoirs, se découvrir des métiers et repartent sans partager ou garder le lien avec la communauté. En empruntant à la théorie des Communs[5], on peut dire que cette attitude propre à de nombreux jeunes Africains en quête d’opportunités est celle des « free riders[6]». Une question se pose alors : faut-il continuer à parler d’inclusion alors que le Fablab ne gagne même pas de la reconnaissance en retour ? Faut-il être plus sélectif et établir des ententes avec les membres ?
Cette volonté d’inclusion s’avère également problématique sur le plan du partage des connaissances. Sénamé Koffi, du Woelab, part des savoirs endogènes de l’architecture traditionnelle africaine pour penser la ville africaine d’aujourd’hui et de demain. L’accès à ces savoirs architecturaux africains a peut-être été facile pour lui, mais cela n’a pas été le cas pour Cécile du Studio Wudé. En effet, les métiers liés au travail du cuir se transmettent de père en fils au Sénégal. N’étant pas issue d’une famille de « travailleurs de cuir », elle a été rejetée et il lui était impossible de partager avec eux ou d’acquérir ce savoir-faire autour du cuir. Cette allusion aux castes de métiers au Sénégal se rapproche des théories autour des communautés de pratiques[7]. On ne saurait vraiment dire s’il y a exclusion ou refus de partage de connaissance. D’une part, on peut justifier l’attitude de la caste des « travailleurs de cuir » comme un repli identitaire visant à se protéger contre l’accaparement des savoirs endogènes par des « free riders ». D’autre part, on peut également justifier qu’il existe bel et bien un partage des connaissances entre les membres de cette communauté, puisqu’il y a transmission de père en fils. Une fois de plus, le silence du maroquinier de Thiès sur la question vaut le détour. Même s’il est vrai que la culture du secret ne fait pas partie des idéologies véhiculées par les Fablabs, on peut se poser la question de savoir si l’idée d’inclusion dans les Fablabs ne devrait pas s’inspirer du fonctionnement des familles, des ethnies et des castes africaines ?
Au vu des idées qui ressortent des discussions de ce panel, il va sans dire que les Fablabs sont dotés d’un puissant potentiel capable de booster une innovation qui corresponde aux besoins des populations africaines. Cependant, tels qu’ils sont pensés et véhiculés actuellement, ils relèvent d’une utopie qui aura du mal à se concrétiser en Afrique. Il s’avère donc important de les repenser sur des bases socioculturelles propres à l’Afrique ; d’où l’importance de l’approche anthropologique que je souhaite adopter dans le cadre de l’étude que je fais sur les Fablabs en Afrique.
[1] C’est fort de ce panel assez diversifié et du public cosmopolite (très actif d’ailleurs) que je me suis permis d’utiliser le mot Afrique dans mon titre, pour signifier que nos discussions ne se sont pas limitées au contexte sénégalais.
[2] Chris Anderson and Michel Le Séac’h, Makers: la nouvelle révolution industrielle (Paris: Pearson, 2012).
[3] Thomas Hervé Mboa Nkoudou, ‘Benefits and the Hidden Face of the Maker Movement: Thoughts on Its Appropriation in African Context| Os Benefícios E a Face Oculta Do Movimento Maker: Reflexões Sobre Sua Apropriação No Contexto Africano’, Liinc Em Revista, 13.1 (2017).
[4] Le Développement Durable, ed. by Gabriel Wackermann, Carrefours. Les Dossiers (Paris: Ellipses, 2008).
[5] Elinor Ostrom, Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, The Political Economy of Institutions and Decisions (Cambridge ; New York: Cambridge University Press, 1990).
[6] Hervé Le Crosnier, En communs: Une introduction aux communs de la connaissance, Avec un code pour télécharger la version epub (C&F Editions, 2015).
[7] Etienne Wenger, Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity, Learning in Doing (Cambridge, U.K. ; New York, N.Y: Cambridge University Press, 1998).